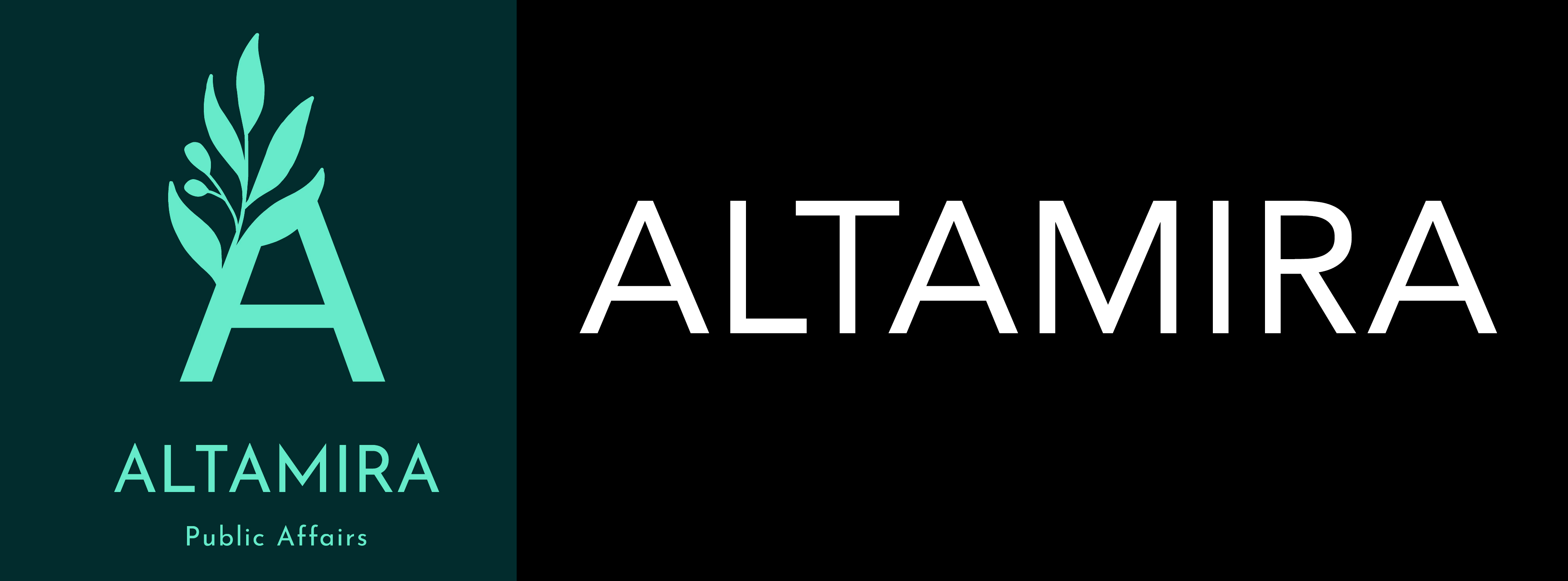La question du climat a été déterminante pour les élections de 2014, marquant une hausse de la participation, notamment des jeunes électeurs, autour de cette urgence. Les élections du 9 juin 2024 semblent annoncer un virage, celui du clivage. Si la question du climat demeure au cœur des objectifs annoncés par les principaux responsables européens, les candidats ne manquent pas de mettre en avant les conséquences sociales et les éventuelles ambiguïtés des politiques européennes, comme cela est apparu lors des mobilisations d’agriculteurs.
LA POLITIQUE EUROPEENNE DU CLIMAT : DES OBJECTIFS LARGES ET ENGLOBANTS QUI IMPOSENT UN EFFORT DE TRANSITION.
L’environnement : une compétence devenue priorité à l’Échelle de l’UE.
La politique européenne de l’environnement, fondée sur les articles 11 et 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mobilise aujourd’hui 30% des budgets européens. Elle traite de thématiques allant de la qualité de l’air à l’agriculture en passant par le changement climatique et étend ses objectifs dans tous les compartiments de son action. Depuis 2019, après un vote des Européens, cette politique est incarnée par le Pacte vert qui énonce de grandes ambitions : faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone, initiant une nouvelle ère comparable, selon Ursula Von der Leyen, à celle de la conquête spatiale.
Il faut néanmoins noter l’antériorité et la progressivité de la politique environnementale européenne, initiée par la directive “Oiseaux” de 1979. En 1986, l’Acte unique européen a formalisé pour la première fois la compétence spécifique de l’UE sur le plan environnemental. Le traité de Maastricht de 1992 a introduit la codécision en matière de politique environnementale. Une étape importante est reconnue par le traité d’Amsterdam de 1997, qui reconnaît le principe de développement durable, défini par le rapport Brundtland de 1987 et précisé lors du sommet de la Terre de Rio en 1992. Le traité de Lisbonne de 2007 a ajouté un nouvel objectif : la promotion de mesures internationales pour lutter contre les problèmes environnementaux, en particulier le changement climatique.
La pleine ambition actuelle de l’UE sur le sujet est matérialisée par le 8ème programme d’action pour l’environnement (2021-2030), autour d’objectifs principaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, et la recherche d’une pollution zéro. La loi climat de juillet 2021 a intégré cet objectif en droit, avec une cible intermédiaire de réduction nette des gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et une proposition de réduction de 90 % d’ici 2040, visant la neutralité carbone d’ici 2050.
A qui revient la responsabilité des réductions d’émissions?
En juillet 2021, le paquet “Fit for 55” engage des propositions législatives pour atteindre la réduction des émissions de GES de 55 % d’ici 2030 avec un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, la fin de la vente des nouvelles voitures essence et diesel à partir de 2035, et le programme Farm2Fork dans l’agriculture. Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), instauré en 2005, est un élément central de cette politique.
Se pose alors concrètement la question des véritables protagonistes de l’application des mesures environnementales. La mécanique du Pacte vert mise également sur une croissance liée à la transition environnementale et notamment énergétique. Cependant, dans un contexte de transition technologique soumis à de forts effets d’inertie, qui devra soutenir l’effort en priorité? C’est la question très concrète posée à notre agriculture, à notre industrie automobile, à nos filières du bâtiment, à nos collectivités avec le risque que ces mesures n’affectent la compétitivité à court et moyen terme.
Financements européens et programmes de transition : des leviers de croissance confrontés à la concurrence internationale.
La transition environnementale représente actuellement 30% de l’engagement budgétaire de l’UE. Tous les programmes doivent inclure entre 30 et 40% (dans le cas du pacte vert) d’investissements dédiés à la transition environnementale. Le programme LIFE, principal instrument de l’UE pour l’environnement, dispose d’un budget de 5,4 milliards d’euros pour 2021-2027. D’autres initiatives incluent le programme Horizon Europe pour la recherche et le Fonds européen de développement économique régional (FEDER) pour une économie bas carbone. Le Fonds pour une transition juste (FTJ) et le Fonds de solidarité de l’UE apportent un soutien supplémentaire aux activités et territoires affectés par ce vaste mouvement qui englobe l’ensemble de notre économie.
Dans le cas de l’agriculture et de la diminution des pollutions, les nouveaux objectifs de la PAC destinés à « verdir » l’agriculture, ainsi que la politique “De la ferme à la table” de 2020, semblent rencontrer les premières limites quant à l’acceptabilité des mesures. Si tous souscrivent à des objectifs louables : un système alimentaire équitable et respectueux de l’environnement, la restauration de la nature pour réparer les dommages causés par les activités humaines, les effets redoutés sur la compétitivité des exploitations dans un contexte économique tendu par le COVID et le conflit en Ukraine demeurent une préoccupation majeure.
Cette logique peut être déclinée à tous les secteurs de l’économie. Si l’UE s’efforce d’améliorer la qualité de l’air, de fixer des normes pour les polluants, et de renforcer la réparation des dommages environnementaux, le passage aux mobilités électriques impose une pression sur les industries minières, tandis que le conflit en Ukraine suggère une relance des industries lourdes.
En parallèle, les difficultés d’approvisionnement liées au COVID, puis la crise énergétique liée au conflit ukrainien ont relancé une mécanique inflationniste qui fragilise encore nos activités économiques les plus vulnérables et les citoyens des classes moyennes, venant porter un coup au pacte de prospérité et démocratie qui a présidé à la construction européenne.
CLIMAT ET ELECTIONS EUROPEENNES EN FRANCE : SUJET MAJEUR DE MOBILISATION MAIS AUSSI DE CLIVAGE.
Climatosepticisme ? Euroscepticisme ?… Une question de priorités ?
Si l’on en croit les vagues successives de l’Eurobaromètre, notamment celle de juillet 2023, les Français ne semblent pas frappés de climatoscepticisme, reconnaissant la nécessité d’une action collective et individuelle pour faire face à l’enjeu. Il y a également une reconnaissance de la complexité du problème, nécessitant l’engagement de divers acteurs à différents niveaux de gouvernance pour une réponse efficace. On relève cependant que le sujet se place aujourd’hui, avec 16%, au 6ème rang des bénéfices perçus de l’Europe pour leur pays, distancé par les questions de stabilité et de paix sur notre continent.
Le changement climatique, préoccupation bien présente et éprouvée par chacun dans son expérience personnelle, reste encore plus abstrait que la guerre en cours et ses conséquences, notamment économiques. Il faudra attendre l’issue des élections pour en faire le bilan, mais ces indicateurs semblent révéler un contraste avec l’échéance électorale de 2019.
En 2019, l’étude post-élections du Parlement européen (Eurobarometer Survey 91.5 of the European Parliament) avait recensé les motivations des électeurs. Pour 37% des répondants, le vote était conditionné par la proximité avec un parti, les questions de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement. L’étude notait également que la question environnementale est intégrée par les électeurs à leur réflexion sur leur vie de manière générale. Le rapport soulignait enfin le lien entre la participation accrue des jeunes électeurs et les questions environnementales.
Nouvelles craintes, nouvelles mobilisations et vieux clivages
Le pacte vert et ses objectifs se trouvent donc fragilisés à plus d’un titre. Recueillant un consensus relativement large, l’enjeu climatique se trouve en concurrence avec des questions de sécurité, d’économie, de détresse sociale perçues comme plus immédiates. Les acteurs politiques opposés à ces orientations se sont par ailleurs saisis des inquiétudes des citoyens européens. Dans un contexte de crise de légitimité perçue de l’UE, mais aussi des exécutifs des États membres qui la composent, on a pu constater un recul des ambitions du pacte vert face aux opinions européennes.
À titre d’exemples, le terme de cette dernière mandature a été marqué par la réduction des objectifs de la stratégie Farm2Fork, la suppression des obligations de restauration des terres agricoles dans la loi de restauration de la nature, et les dispositions sur les polluants chimiques lors de la refonte du règlement REACH. Sans présumer des résultats des élections du 9 juin 2024, les grandes tendances laissent percevoir des majorités plus incertaines en faveur d’une transition environnementale accélérée.
S’il ne fait aucun doute que les citoyens européens souhaitent garantir un avenir durable
pour l’Europe, la traduction de ces objectifs dans les urnes semble s’acheminer vers un clivage qui perdure depuis Maastricht : une idée de transition environnementale européenne majoritairement soutenue par des populations urbaines, diplômées et bénéficiant des effets de l’ouverture européenne. Cet article sera bien évidemment suivi et révisé à l’issue des élections, mais il semble que pour bien des Européens, le pacte vert recueille le désenchantement déjà exprimé sur les sujets de construction institutionnelle.